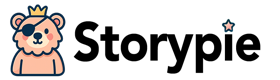Nelson Mandela : Mon long chemin vers la liberté
Bonjour, je m'appelle Nelson Mandela, mais ce n'est pas le nom que j'ai reçu à ma naissance. Je suis né le 18 juillet 1918, et on m'a donné le nom de Rolihlahla. Dans ma langue, le xhosa, cela signifie « tirer la branche d'un arbre », ou plus simplement, « fauteur de troubles ». C'était peut-être un signe de la vie que j'allais mener. J'ai grandi dans le petit village paisible de Qunu, dans une région de l'Afrique du Sud appelée le Transkei. Mes souvenirs d'enfance sont remplis de soleil, de course pieds nus dans les champs verdoyants et de baignade dans les ruisseaux frais. La vie était simple, connectée à la terre et à nos traditions. Le soir, nous nous réunissions autour du feu pour écouter les anciens raconter des histoires sur nos ancêtres, des histoires de courage et de sagesse qui ont planté en moi les graines de ce que je deviendrais. Mon père était un conseiller du roi du peuple Thembu, et je l'observais attentivement. Il m'a appris l'importance de la justice, de l'écoute et de la direction par l'exemple. Il m'a appris qu'un vrai leader ne cherche pas à être le premier, mais à élever les autres. Cependant, le monde en dehors de mon village était en train de changer. Quand j'ai commencé l'école, mon institutrice, suivant une coutume de l'époque qui consistait à donner des noms anglais aux enfants africains, m'a appelé « Nelson ». C'est sous ce nom que le monde entier allait me connaître. Mais au fond de mon cœur, j'étais toujours Rolihlahla, le garçon de Qunu, dont l'esprit était façonné par les traditions et les valeurs de son peuple.
En grandissant, j'ai quitté mon village pour poursuivre mes études, un voyage qui m'a finalement conduit dans la grande ville animée de Johannesburg en 1941. C'était un monde complètement différent de la tranquillité de Qunu. Pour la première fois, j'ai été confronté à la dure réalité d'un système cruel appelé apartheid. Ce mot, qui signifie « séparation » en afrikaans, était bien plus qu'une simple séparation. C'était un système de lois qui classait les gens en fonction de la couleur de leur peau. Les Noirs, qui constituaient la majorité de la population, étaient traités comme des citoyens de seconde zone dans leur propre pays. On nous disait où nous pouvions vivre, travailler et même nous asseoir. Nous n'avions pas le droit de voter et nos possibilités étaient sévèrement limitées. Voir cette injustice profonde chaque jour a allumé un feu en moi. J'ai décidé d'étudier le droit pour pouvoir défendre mon peuple. En 1952, avec mon cher ami Oliver Tambo, nous avons ouvert le premier cabinet d'avocats noir d'Afrique du Sud. Notre bureau était un havre d'espoir pour de nombreuses personnes qui n'avaient nulle part où aller. Nous avons défendu des gens qui avaient été injustement chassés de leurs maisons ou qui avaient été maltraités simplement à cause de leur race. Cependant, j'ai vite compris que lutter contre des cas individuels ne suffisait pas. Le système lui-même devait changer. C'est pourquoi j'ai rejoint le Congrès National Africain (ANC), une organisation qui luttait pour les droits et la liberté de tous les Sud-Africains. Je suis passé d'avocat à militant, consacrant ma vie à la lutte pour un pays juste et équitable, où la valeur d'une personne ne serait pas déterminée par la couleur de sa peau, mais par le contenu de son caractère.
La lutte pour la liberté est rarement facile. Pendant des années, nous, à l'ANC, avons protesté pacifiquement. Nous avons organisé des marches, des boycotts et des manifestations, en espérant que nos voix seraient entendues. Mais au lieu de dialogue, nous avons été accueillis par une violence croissante de la part du gouvernement de l'apartheid. En 1960, lors d'une manifestation pacifique à Sharpeville, la police a ouvert le feu sur la foule, tuant 69 personnes. Cet événement tragique a été un tournant. Nous avons réalisé avec une grande tristesse que nos méthodes pacifiques ne suffisaient plus. C'est alors que nous avons pris la décision incroyablement difficile de former une branche armée de l'ANC. Ce n'était pas un choix que nous avons fait à la légère ; nous sentions que nous n'avions plus d'autre option pour nous défendre et lutter pour notre liberté. À cause de mes activités, j'ai été contraint de vivre dans la clandestinité, mais j'ai finalement été arrêté en 1962. Mon procès, connu sous le nom de procès de Rivonia, a eu lieu en 1964. C'est là que, depuis le banc des accusés, j'ai parlé au monde. J'ai expliqué pourquoi nous nous battions et j'ai terminé mon discours par des mots qui venaient du plus profond de mon cœur : « J'ai chéri l'idéal d'une société démocratique et libre dans laquelle toutes les personnes vivent ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère atteindre. Mais si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » J'ai été condamné à la prison à vie. J'ai passé les 27 années suivantes derrière les barreaux, dont 18 sur la tristement célèbre île de Robben. C'était un endroit froid et impitoyable. Nous travaillions dur dans une carrière de chaux, et les conditions étaient difficiles. Mais même dans les moments les plus sombres, nous n'avons jamais perdu espoir. Nous avons transformé notre prison en une université. Nous étudiions, nous débattions, et nous communiquions secrètement pour maintenir notre lutte en vie. Nous savions, avec une certitude inébranlable, que l'apartheid ne durerait pas éternellement et qu'un jour, nous serions libres.
Après 27 longues années, ce jour est enfin arrivé. Le 11 février 1990, j'ai franchi les portes de la prison en homme libre. Le soleil sur mon visage semblait être une promesse d'un avenir meilleur. Mais mon long chemin vers la liberté n'était pas terminé. L'Afrique du Sud était toujours un pays profondément divisé et blessé. Ma tâche consistait maintenant à aider à le guérir. J'ai commencé à travailler avec le président de l'époque, F.W. de Klerk, l'homme même qui représentait le système qui m'avait emprisonné. Beaucoup trouvaient cela étrange, mais je savais que pour construire un avenir pacifique, nous devions parler à nos anciens ennemis. La réconciliation était plus importante que la vengeance. Ensemble, nous avons négocié la fin de l'apartheid et préparé le terrain pour un nouveau pays. Le moment le plus joyeux de ma vie est arrivé le 27 avril 1994. Ce jour-là, pour la toute première fois dans l'histoire de notre nation, tous les Sud-Africains, quelle que soit la couleur de leur peau, ont pu voter. C'était un spectacle magnifique de voir de longues files de personnes, noires et blanches, attendant patiemment de déposer leur bulletin de vote. C'était l'aube d'une nouvelle ère. Peu de temps après, j'ai eu l'immense honneur d'être élu premier président d'une Afrique du Sud démocratique. Nous avons appelé notre nouvelle nation la « Nation Arc-en-ciel », un lieu où toutes les couleurs et toutes les cultures pouvaient vivre ensemble en paix. Mon travail en tant que président consistait à unir notre peuple et à reconstruire notre pays sur des fondations de pardon et d'égalité. Ma vie s'est achevée le 5 décembre 2013, mais mon histoire, je l'espère, continue d'inspirer. Elle montre qu'avec du courage, de la détermination et une foi inébranlable en l'humanité, une personne peut vraiment aider à changer le monde pour le mieux.
Questions de compréhension de lecture
Cliquez pour voir la réponse