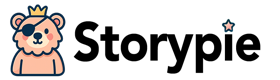Johannes Gutenberg et la Révolution de l'Imprimerie
Je m'appelle Johannes Gutenberg, et je suis un artisan qui a vécu à Mayence, en Allemagne, au XVe siècle. À mon époque, le monde était très différent de celui que vous connaissez. Les livres étaient des trésors rares et précieux, plus précieux que l'or pour ceux qui, comme moi, aimaient les histoires et le savoir. Chaque livre était méticuleusement copié à la main par des moines appelés scribes, une lettre à la fois, avec une plume et de l'encre. Imaginez le temps que cela prenait. Un seul livre pouvait nécessiter des mois, voire des années, de travail. À cause de cela, seuls les rois, les nobles et les membres les plus riches du clergé pouvaient se permettre d'en posséder. Cette situation me frustrait profondément. Je voyais la connaissance enfermée dans les monastères et les bibliothèques privées, inaccessible à la plupart des gens. Je rêvais d'un monde où les idées, les histoires et les découvertes pourraient voyager librement, où un fermier ou un marchand pourrait lire les mêmes mots qu'un prince. Je me disais souvent, en regardant un scribe travailler, qu'il devait y avoir un moyen plus rapide, un moyen de créer des centaines de copies d'une page aussi facilement qu'une seule. Cette idée est devenue une obsession, une étincelle qui refusait de s'éteindre dans mon esprit.
C'est dans le secret de mon atelier que mon rêve a commencé à prendre forme. En tant qu'orfèvre, j'étais habitué à travailler le métal avec une grande précision. C'est ce savoir-faire qui m'a donné l'idée la plus importante de ma vie : et si, au lieu de copier une page entière, je créais de petites lettres individuelles en métal ? Chaque lettre, chaque signe de ponctuation, moulé dans un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine, pourrait être assemblé pour former des mots, des lignes, des pages entières. Et le plus beau, c'est qu'une fois la page imprimée, on pourrait démonter le tout et réutiliser les lettres pour la page suivante. C'était le principe des caractères mobiles. Mais l'idée était plus facile que la réalisation. J'ai passé des années à perfectionner mes petits caractères métalliques. Puis est venu un autre défi : l'encre. L'encre des scribes, à base d'eau, glissait sur le métal. Il me fallait une encre plus épaisse, à base d'huile, qui adhérerait au métal sans baver sur le papier. J'ai fait d'innombrables essais, mélangeant suie, vernis et huile de lin, jusqu'à trouver la consistance parfaite. Enfin, il me fallait une presse. J'ai observé les pressoirs à vin utilisés par les vignerons de ma région et j'ai eu l'idée de l'adapter. J'ai construit une grande machine en bois capable d'appliquer une pression uniforme et puissante. Je n'oublierai jamais le jour où, après tant d'échecs, j'ai encré mes caractères, placé une feuille de papier et actionné le levier. En retirant la feuille, j'ai vu des lettres noires, nettes et parfaites. Ce n'était qu'une seule page, mais pour moi, c'était le monde entier qui venait de changer.
Avec ma méthode au point, j'ai décidé de me lancer dans un projet incroyablement ambitieux : imprimer la Bible. C'était le livre le plus important de notre temps, et je voulais prouver que ma machine pouvait produire une œuvre aussi belle et digne que les manuscrits des moines. Ce fut une entreprise colossale. Mon atelier bourdonnait d'activité. Le cliquetis des caractères métalliques qu'on assemblait, l'odeur forte de l'encre huileuse et le grincement régulier de la presse rythmaient nos journées. Nous avons travaillé sans relâche, mon équipe et moi, pour créer près de deux cents exemplaires de cette Bible de plus de 1 200 pages. Chaque page était arrangée avec 42 lignes de texte, d'où son nom de « Bible à 42 lignes ». Cependant, un tel projet coûtait une fortune en métal, en papier et en salaires. J'ai dû m'associer avec un riche homme d'affaires, Johann Fust, qui m'a prêté l'argent nécessaire. Malheureusement, avant que le projet ne soit entièrement terminé et rentable, Fust est devenu impatient. Il a exigé le remboursement de sa dette, et comme je ne pouvais pas payer, un tribunal lui a accordé la possession de mon atelier, de mes presses et de tous mes caractères. J'ai tout perdu. C'est lui qui a finalisé les dernières copies et qui a récolté les fruits de mon travail. Mon chef-d'œuvre était achevé vers 1455, mais il ne m'appartenait plus.
Malgré cette déception personnelle, mon idée, elle, était libre. Je n'ai peut-être pas connu la richesse, mais j'ai assisté à quelque chose de bien plus grand. L'invention de l'imprimerie ne pouvait plus être contenue entre les murs d'un seul atelier. Mes anciens ouvriers ont essaimé à travers l'Europe, emportant avec eux le secret de la fabrication des caractères mobiles et de la presse. En quelques décennies, des imprimeries ont vu le jour dans toutes les grandes villes. Le prix des livres a chuté de façon spectaculaire. Soudain, le savoir n'était plus un privilège. Les scientifiques pouvaient partager leurs découvertes, les philosophes pouvaient diffuser leurs idées, et les gens ordinaires pouvaient lire les textes sacrés dans leur propre langue. Cette diffusion rapide de l'information a alimenté d'immenses changements culturels et sociaux, comme la Renaissance et la Réforme protestante. Mon rêve s'était réalisé au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Mon histoire vous enseigne qu'une invention ne vous appartient pas vraiment. Une fois partagée, elle appartient au monde. Parfois, la plus grande récompense n'est pas l'or que l'on gagne, mais le changement que l'on inspire. Une seule idée, née dans le secret d'un atelier, peut véritablement éclairer le monde entier et donner le pouvoir de la connaissance à des millions de personnes pour les siècles à venir.
Questions de compréhension de lecture
Cliquez pour voir la réponse